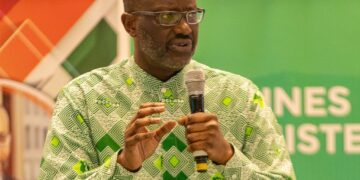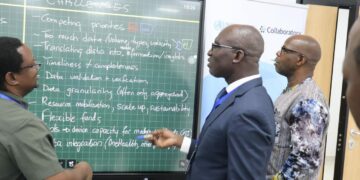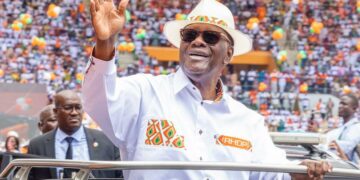C’est un rêve qui se réalise. La Côte d’Ivoire a son tout premier musée archéologique. Après la pose de la première pierre le 4 juillet 2024, la première aile de l’édifice bâti sur un espace de 7.000 m2, a été inaugurée, le lundi 30 juin, à Ahouaty (sud). La cérémonie s’est déroulée en présence de la ministre de la culture, Françoise Remarck, et de la conseillère fédérale suisse, Elisabeth Baume-Schneider, ainsi que du Président du Conseil Régional de l’Agneby- Tiassa, le Ministre de la Santé, Pierre Dimba, de personnalités et d’archéologues.
Comment est né ce projet de musée archéologique à Singrobo-Ahouaty ?
Le projet est né dans le cadre des recherches archéologiques préventives rendues nécessaires par la construction du barrage hydroélectrique de Singrobo-Ahouaty. Conformément aux standards internationaux, il était impératif de procéder à des fouilles afin de préserver les sites et vestiges archéologiques menacés par les travaux. En effet, le site de Singrobo-Ahouaty fait partie du grand ensemble appelé le « V Baoulé ». Il y a une grande concentration de sites préhistoriques et protohistoriques de la Côte d’Ivoire sur cet espace, rendue possible grâce à l’environnement préhistorique favorable à l’installation de l’Homme. Un contact forêt-savane favorable à une diversité environnementale au niveau de la flore, de la faune, et par ricochet des différentes espèces vivantes, en un mot, des ressources végétales et animales exploitables dans les milieux naturels de la Préhistoire et de la Protohistoire. Les prospections archéologiques ont prouvé cette richesse archéologique. Le Ministère en charge de la Culture ne pouvait pas laisser à la destruction ce patrimoine archéologique unique. Il fallait le préserver et également le valoriser dans son contexte environnemental. Très vite, l’idée a émergé de ne pas se limiter à la simple sauvegarde, mais de valoriser ce patrimoine à travers un musée, premier du genre en Côte d’Ivoire, à l’image des premiers hommes qui s’y sont installés.
Ce musée est présenté comme le premier du genre en Côte d’Ivoire et en Afrique de l’Ouest francophone. Pourquoi ça a mis si longtemps ?
À la fin des années 1970 et au début des années 1980, la Côte d’Ivoire, sous l’impulsion du Président Félix Houphouët-Boigny, amorce une politique volontariste de recherche et de valorisation de son patrimoine archéologique et historique. Cette vision, profondément ancrée dans un projet de construction identitaire et de consolidation de l’unité nationale, reconnaît à l’archéologie un rôle central dans la mise en lumière des civilisations anciennes ayant marqué le territoire ivoirien. Cette vision du Président de la République a abouti à la création de l’IHAAA (l’Institution d’Histoire d’Art et d’Archéologie Africains) en 1969. Son objectif principal était la valorisation des identités et du patrimoine africains, engagé après les indépendances. C’est dans ce contexte que furent lancées les premières grandes campagnes de fouilles archéologiques sur deux sites emblématiques : la ville historique de de Kong et les sites des îles Eotilé, prenant en compte les aires culturelles du Nord et du Sud de la Côte d’Ivoire à la recherche de la consolidation de la Cohésion sociales. Cependant, lorsque l’archéologie amorce son ascension, la crise économique frappe l’économie ivoirienne de plein fouet. L’archéologie est ainsi donc éclipsée par d’autres urgences nationales, comme le développement économique et les défis sociaux. Par ailleurs, il faut reconnaître que l’archéologie, discipline pourtant essentielle à la compréhension de nos origines, a été longtemps sous-financée et peu visible. Enfin, il existe peu d’infrastructures adaptées pour accueillir, conserver et exposer les objets archéologiques dans des conditions scientifiques et muséales adéquates. Ce projet marque donc un tournant historique.
Le site choisi est celui du futur barrage hydroélectrique. À première vue, ça semble étrange de mettre un musée sur une énorme infrastructure comme un barrage.
Au contraire, ce choix est porteur de sens. Le barrage a permis de révéler la richesse archéologique de la région, et il était symboliquement cohérent que le musée s’installe à proximité des découvertes. C’est aussi une manière innovante de concilier développement économique et préservation du patrimoine. Ce modèle, qui associe grands projets d’infrastructures et valorisation culturelle, est d’ailleurs encouragé par les organisations internationales comme l’UNESCO. Aussi comme je vous l’ai dit, c’est sur cet espace que ce sont installés en nombre important, les hommes préhistoriques, pourquoi ne pas leur rendre hommage en restant dans leur environnement naturel ?
Il y a des sites archéologiques immobiles, comme les meules dormantes, qui sont aux alentours du musée que nous devons valoriser. Cela nous permet de prendre en compte l’ensemble du patrimoine archéologique. En plus de cela, c’est un gros complexe touristique que nous voulons mettre en place. Nous avons un ensemble d’élément qui est favorable à un tourisme de la mémoire et de la nature. Il s’agit de la mare aux hippopotames (ou zone fluviale propice à l’observation des hippopotames), du parcours écologique autour du barrage et du fleuve, du jardin botanique patrimonial, de l’exploitation culturelle des éléments naturels, de la valorisation géologique etc.
D’où viennent les objets qui composeront le fonds muséal ?
Le fonds muséal est constitué des vestiges issus de fouilles des régions de la Côte d’Ivoire et principalement des vestiges exhumés lors des fouilles préventives menées à Singrobo-Ahouaty entre 2018 et 2023 dans le cadre du projet du barrage. Ces objets témoignent de l’occupation humaine ancienne de la région, allant du Paléolithique jusqu’aux périodes contemporaines. Mais le musée a également vocation à accueillir à terme des objets archéologiques provenant de toutes les régions du pays, dans une perspective nationale, pour illustrer la diversité et la richesse du patrimoine ivoirien.Comment et par qui a été construite l’exposition ? Quel choix scénographique a été fait ?L’exposition est le fruit d’une collaboration entre plusieurs partenaires : les archéologues des universités de Côte d’Ivoire et du Ministère de la Culture et de la Francophonie, des muséographes suisses et ivoiriens, ainsi que des spécialistes de la scénographie muséale. Le choix scénographique s’est voulu sobre, pédagogique et immersif. L’accent est mis sur la compréhension des grandes étapes de l’occupation humaine de la région, avec des supports modernes et accessibles à tous les publics.Le projet bénéficie d’un financement international, notamment suisse.
Quelle est la part de la contribution ivoirienne ? La Côte d’Ivoire garde-t-elle toute sa liberté sur ce projet ?
Le financement suisse, à travers la Fondation Suisse pour la Recherche Archéologique à l’Étranger et le soutien du Gouvernement Suisse, a été déterminant, notamment pour les fouilles archéologiques et les équipements muséaux. Mais la Côte d’Ivoire a pleinement assumé son rôle : par la mise à disposition du site, l’encadrement scientifique des recherches, la formation des jeunes chercheurs, et le pilotage institutionnel du projet. Notre pays reste souverain dans la gestion, les contenus et l’orientation de ce musée. Ce projet démontre surtout que la culture est un terrain propice à des coopérations internationales équilibrées et respectueuses.
Au-delà de la conservation, quelles sont les ambitions du musée en matière d’éducation, de recherche et de rayonnement culturel régional ?
Ce musée n’est pas simplement un lieu de conservation. Il constitue un maillon essentiel d’une vision plus large portée par la Côte d’Ivoire, à travers la création du Centre National d’Archéologie. Ce Centre, en cours de structuration, a pour mission de coordonner la recherche archéologique et l’archéologie préventive sur l’ensemble du territoire, de renforcer la formation académique des jeunes chercheurs, et d’assurer la valorisation scientifique et muséale des découvertes.Dans ce cadre, le Musée archéologique de Singrobo-Ahouaty se positionne comme :-Un centre d’éducation patrimoniale pour sensibiliser les jeunes générations à l’importance de notre histoire et de notre patrimoine. -Un espace de recherche appliquée, en étroite collaboration avec les universités ivoiriennes, les archéologues du CNA et les partenaires internationaux.-Un pôle muséal régional, qui contribuera au rayonnement culturel, touristique et scientifique non seulement de la région de Taabo, de toute la Côte d’Ivoire et de l’Afrique de l’Ouest en général.Le musée et le Centre National d’Archéologie travailleront en synergie pour :Développer des programmes éducatifs et des visites pédagogiques adaptées aux écoles et universités.Former de nouvelles générations d’archéologues et de spécialistes du patrimoine.Valoriser les résultats des recherches par des expositions permanentes et temporaires.Renforcer l’attractivité touristique de la région par une offre culturelle intégrée.Nous souhaitons ainsi que le musée et le CNA deviennent des outils concrets de développement local, mais aussi des vitrines du riche passé et du dynamisme scientifique de la Côte d’Ivoire sur la scène régionale et internationale.
Peut-on imaginer d’autres musées archéologiques dans le pays, ou ouvrir celui-là à des cultures régionales ?
Absolument. Singrobo-Ahouaty constitue une première étape qui sera le Musée National d’Archéologie qui réceptionnera les pièces emblématiques de toutes les régions. D’autres projets sont envisagés, notamment dans les régions du Nord, à Kong, dans le Poro, les îles Eotilé etc. où les découvertes archéologiques sont nombreuses. Le musée lui-même a vocation à s’enrichir progressivement avec des objets représentatifs des différentes cultures régionales du pays.
L’idée est de construire à terme un véritable réseau muséal archéologique en Côte d’Ivoire.Où en est le musée d’art contemporain ?
Le projet du Musée d’Art Contemporain suit son cours. Les travaux d’aménagement avancent, et nous avons engagé un dialogue avec les artistes, les mécènes et les experts afin de faire de ce futur musée un espace vivant, au service de la créativité ivoirienne et africaine. Nous espérons pouvoir bientôt annoncer une date officielle d’ouverture.