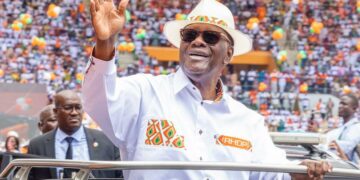Il y a des prises de position qui, en s’annonçant comme courageuses, finissent par révéler les plus troublantes inconsistances. Ainsi en est-il du discours récemment tenu par le député Assalé Tiémoko, à propos de la grève des enseignants en Côte d’Ivoire.
Flanqué de l’armure du défenseur des droits constitutionnels, l’homme s’érige en modèle d’une démocratie à géométrie variable où la légalité de l’acte prévaut sur sa légitimité morale.
L’école, sanctuaire du savoir, devient alors l’arène d’un bras de fer où les plus jeunes, ceux qui n’ont ni syndicat ni tribune paient le prix d’un conflit d’adultes trop pressés.
Assalé Tiémoko, défenseur du spectacle de l’indignation
Député du peuple, il se pose en messager de la justice sociale mais semble oublier que défendre le droit de grève n’exonère nullement d’un devoir de conscience. En affirmant que « la grève est un droit constitutionnel », ce qui est juridiquement incontestable, il passe sous silence une vérité plus dérangeante : ce droit, lorsqu’il s’exerce sans discernement, devient l’arme d’un chantage à ciel ouvert.
Car enfin, quel esprit raisonnable peut défendre l’idée que l’enseignant, par sa seule colère, puisse suspendre l’avenir d’une classe entière ? À ce rythme, la salle de classe n’est plus qu’un théâtre vide où la pédagogie cède la place au spectacle de l’indignation.
L’otage en uniforme, quand l’élève devient monnaie de revendication
L’écolier ivoirien, cet innocent oublié du tumulte syndical, devient la victime silencieuse d’une cause qui ne le regarde pas.
Il n’est ni employeur ni décideur, et pourtant c’est lui qu’on prive d’instruction. N’est-ce pas là une forme raffinée de violence psychologique ?
Le député Assalé tiémoko semble ignorer que transformer les enfants en otages institutionnels, c’est porter atteinte à l’article non écrit de toute éthique sociale, qui exige que l’on protège l’innocence de la jeunesse.
Le droit à l’enseignement, un sacré oublié
Le devoir de transmission est l’essence même du métier d’enseignant.
Revendiquer ses droits ne saurait légitimer qu’on suspende ceux des autres, en l’occurrence ceux des enfants, à une volonté gréviste aveuglée par l’impatience.
Si les syndicats ont rompu le dialogue, ce n’est pas parce qu’il n’y avait pas d’écoute, mais parce qu’ils ont préféré le cri à la conversation, la posture à la négociation. Or, toute grève qui refuse l’altérité du dialogue cesse d’être une lutte sociale pour devenir un caprice collectif.
La grève sans la présence, une anomalie de fonctionnement
Dans toute démocratie mûre, la grève signifie présence passive : on vient au travail pour montrer qu’on refuse de le faire. C’est là, le paradoxe fondamental de la grève, elle démontre, par l’absurde, l’importance du travailleur.
Mais sous nos tropiques, elle prend des allures d’escapade. L’enseignant ne vient pas.
L’élève est renvoyé chez lui. L’établissement, déserté, ressemble à un musée de l’abandon.
Où donc est le message ? Et plus encore, où est la responsabilité ? Voilà ce que le député Assalé aurait dû rappeler au lieu d’encenser des pratiques qui violent l’essence même du droit de grève.
Assalé Tiémoko et le harcèlement pédagogique
Justifier une grève qui prend en otage les élèves, c’est avaliser une violence insidieuse, celle qui prive, à intervalles réguliers, une génération de ses droits fondamentaux. N’est-ce pas là un harcèlement moral déguisé ?
Lorsque l’on condamne les enfants à attendre indéfiniment le bon vouloir de leurs maîtres, sans garantie de rattrapage, sans explication claire, on cultive un sentiment d’abandon et de mépris institutionnalisé. Que le député Assalé, habituellement si prompt à dénoncer, trouve ici matière à louange, a de quoi surprendre.
Remettre les pendules pédagogiques à l’heure
Il ne s’agit pas de nier les difficultés du corps enseignant, ni de refuser la légitimité de leurs doléances.
Mais un combat qui oublie ses propres limites devient son propre fossoyeur.
L’école ne saurait être le terrain d’une guérilla syndicale permanente.
Elle est ce lieu sacré où la République enseigne, non seulement les lettres, mais aussi l’exigence du bien commun.
À force de prendre les enfants en otage pour revendiquer, on leur enseigne à devenir des otages consentants.
Kalilou Coulibaly Doctorant EDBA, Ingénieur.