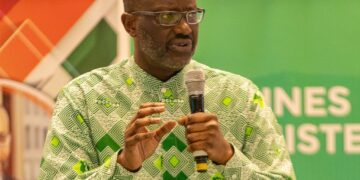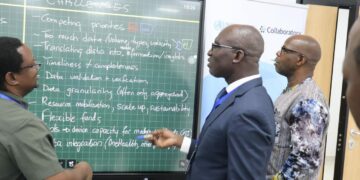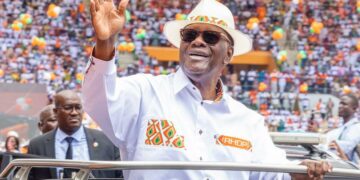Le 30 septembre 2022, le Burkina Faso venait de subir un autre coup d’État, mené par le capitaine Traoré Ibrahim. La forte promesse tenue et avancée pour justifier cette autre instabilité politique et institutionnelle était que Damiba n’a pas respecté ses engagements en matière de sécurité, et qu’il est incapable de faire face à la menace jihadiste, et que la situation exige un changement de commandement pour restaurer l’ordre. Loin de ces résultats militaires, Ibrahim Traoré s’en prend fréquemment à la Côte d’Ivoire dont les accusations contre Abidjan traduisent les fragilités des alliances régionales dans la lutte contre le jihadisme au Sahel et en Afrique de l’Ouest.
Un discours qui interpelle la sous-région
Depuis quelques semaines, les propos du capitaine Ibrahim Traoré, président de la transition burkinabé, suscitent une onde de choc dans les cercles diplomatiques ouest-africains. Dans une interview diffusée récemment, le chef de l’État a frontalement mis en cause la Côte d’Ivoire, accusée de servir de « base arrière des ennemis du Burkina ». Il va plus loin en affirmant que les « opposants burkinabé y trouveraient refuge, bénéficiant, selon lui, de la complaisance des autorités ivoiriennes.
Le capitaine Traoré n’a pas hésité non plus à remettre en cause l’efficacité de l’armée ivoirienne face au terrorisme. Selon lui, le fait que la Côte d’Ivoire ne soit pas régulièrement frappée par les attaques jihadistes ne traduirait pas la supériorité de ses forces de défense, mais pourrait relever d’arrangements tacites avec certains groupes armés. Une déclaration particulièrement sensible, dans un contexte régional déjà marqué par les tensions entre régimes militaires sahéliens et gouvernements civils côtiers. Abidjan avait déjà répondu aux nombreuses accusations du Chef de l’État burkinabé par le porte- parole du gouvernement qui les qualifie d’irréel et imaginaires : « Les accusations d’espionnage contre la Côte d’Ivoire relèvent davantage de fantasme que de faits concrets. Nous avons beaucoup de respect pour le chef de l’État du Burkina. Mais nous attendons toujours les preuves de ces accusations ».
Ces accusations interviennent alors que le Burkina Faso traverse une phase critique de sa lutte contre les groupes affiliés au JNIM (lié à Al-Qaîda) et à l’EIGS (État islamique au Grand Sahara). Dans ce contexte de guerre asymétrique, chaque parole présidentielle prend un poids géopolitique considérable.
La coopération sécuritaire mise à l’épreuve
Historiquement, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire ont entretenu une coopération sécuritaire étroite. Des accords bilatéraux ont permis des échanges de renseignement, la surveillance des frontières communes et parfois des opérations conjointes pour contrer les infiltrations terroristes dans la zone nord ivoirien.
En effet, depuis l’attaque de Kafolo en juin 2020 qui avait coûté la vie à plusieurs soldats ivoiriens, Abidjan a renforcé sa présence militaire dans ses régions septentrionales. Des efforts qui visaient autant à protéger son territoire qu’à prévenir un débordement du conflit sahélien.
Cependant, les propos récents de Ouadougou viennent fragiliser cette confiance mutuelle. En mettant en doute la sincérité et la stratégie ivoiriennes, le capitaine Traoré ouvre la porte à un climat de méfiance qui pourrait réduire l’efficacité de lutte commune contre le terrorisme. Or, les frontières poreuses, notamment autour de Ouangolodougou, Bouna et Doropo, nécessitent justement une coordination renforcée.
Dans le discours burkinabé, la Côte d’Ivoire apparaît désormais non plus comme un partenaire incontournable, mais comme un acteur suspecté de double jeu. Une perception qui, si elle perdure, pourrait compliquer les mécanismes de coopération au sein même de la CEDEAO, dont Abidjan reste un pilier.
III. Lecture géopolitique et enjeux régionaux
Les accusations d’Ibrahim Traoré ne doivent être lues uniquement comme une sortie médiatique ponctuelle. Elles s’inscrivent dans une recomposition géopolitique plus large en Afrique de l’ouest.
- La rivalité stratégique entre États sahéliens et côtiers
Depuis la création de l’Alliance des États du Sahel (AES) regroupant le Burkina Faso, le Mali et le Niger, une fracture s’est creusée avec les pays de la côte ouest-africaine, restés alignés sur la CEDEAO. L’AES affiche un discours souverainiste, critique vis-à-vis des anciens partenaires occidentaux, et se rapproche de nouveaux alliés comme la Russie. Le narratif d’accusations du Burkina renforce la légitimité du régime auprès de sa population et détourne l’attention des difficultés internes (politique démocratique, économie, social, insécurité, terrorisme).
Dans ce cadre, la Côte d’Ivoire, alliée traditionnelle de la France et acteur influent au sein de la CEDEAO, apparaît comme un contrepoids direct aux ambitions régionales de l’AES. Les propos de Traoré traduisent donc autant une méfiance sécuritaire qu’une rivalité politique et diplomatique.
- La bataille des influences extérieures
Le Burkina Faso et ses voisins de l’AES cherchent à diversifier leurs alliances militaires (Russie, Turquie, etc), rompant avec la tutelle sécuritaire francaise. La Côte d’Ivoire de son côté, reste fidèle à ses partenariats occidentaux, tout en développant des coopérations régionales. Cette divergence alimente la suspicion : pour Ouagadougou, Abidjan serait trop proche de l’Occident ; pour Abidjan, le Burkina Faso serait en train de basculer dans une zone d’influence risquée.
- Les risques pour la stabilité régionale
Ces tensions bilatérales pourraient avoir trois conséquences majeures :
- La fermeture du dialogue bilatéral : en s’attaquant publiquement à un voisin clé, le Burkina prend le risque de réduire les marges de manœuvre de la coopération CEDEAO-AES.
- Montée de la méfiance sécuritaire : la coordination militaire transfrontalière pourrait pâtir de cette défiance, laissant des brèches exploitables par des groupes jihadistes.
- Polarisation régionale : une fracture durable entre États sahéliens et côtiers affaiblirait l’unité ouest-africaine face à la menace terroriste, renforcant paradoxalement les ennemis communs.
Conclusion
Les déclarations du capitaine Traoré Ibrahim à l’égard de la Côte d’Ivoire ne relève pas seulement d’une rhétorique polémique. Elles relèvent les lignes de fractures actuelles entre les pays de l’AES et les États côtiers de la CEDEAO, dans un contexte guerre prolongée contre le terrorisme.
En mettant en doute la stratégie ivoirienne, Ouadougou cherche sans doute à renforcer sa légitimité interne et à afficher sa différence géopolitique. Mais cette posture risque de compromettre des coopérations indispensables pour la stabilité régionale.
Dans un Sahel où les jihadistes prospèrent sur les divisions, la question essentielle demeure : la rivalité croissante entre Ouagadougou et Abidjan servira-t-elle les intérêts des peuples ou, au contraire, offrira-t-elle une nouvelle opportunité aux groupes armés de s’étendre.
ADAMA WAGUÉ
Criminologue
Spécialiste en Sécurité Internationale et Stratégie